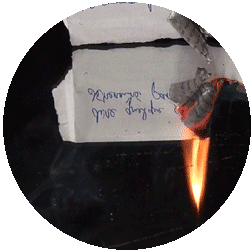Un statue, allongée, déesse, femme au sexe offert, jambes lourdes et l’épaule, le visage a roulé quelque part.
Lui, il collectionne ces rocs qui croisent son chemin. Son musée est infiniment lourd, toujours plus lourd. Rocs, tel est ce corps de femme et vu de ses pieds c’est un roc reposé. Avec lui son jumeau dans cet autre pays, une fente de haut en bas, sur cette pierre masse, carré arrondi.
Plus haut, en remontant sur la route, le musée avec toutes les choses qui sont plus que de simples pierres de construction. Au clair tout est joliment conservé, exposé, expliqué, démontré. Scénographie de gravures, sculptures, vases précieux et pierre précieuse, reconstitutions, bijoux, bols, peignes, miroirs de pierre lisse. Le musée est désert la nuit tombe. Je suis la dernière au milieu des surveillants de salle. Il est trop tard pour le bus.
J’essaie de comprendre ce que me dit la vendeuse de tickets du musée, très réticente à m’expliquer comment rentrer au village. Elle et ses compagnes ne peuvent me regarder directement.
Je sors, noir complet, pas d’arrêt de bus, comme promis, sur la route, vers le village. Pas de lune. Je marche sur cette route sans lampadaire, seuls les phares des voitures m’éclairent, m’éclaboussent aux yeux des conducteurs. Je me vois par eux. Dans l’obscurité je suis intègre, cachée, animale. J’écoute le vent parfois.
Je m’essouffle. Ce souffle. Chaleur à la peau, pas de couleur qui ne se voie mais mon râle. Le corps est bavard. Comme se divise l’espace par cette bande goudronnée, où rien ne s’élève. A sa droite, à sa gauche. A sa droite le vide ou les choses, à sa gauche la pente, montante, et ses choses. Tout ce qui m’entend souffler. Dissimuler ce souffle, le diviser par une large bande de silence, il déborde à droite et à gauche.
Avce les phares je suis un lampion clignotant. Visage/pas de visage.
Découvert tardivement, la farce de la lampe de poche placée sous le menton pour effrayer ne m’a jamais effrayée, ni fait rire.
Visage pour les phares. Les phares sont utilisés par des personnes aux commandes d’une machine, ils leur permettent de voir au devant de cette machine, assez rapidement pour éviter tout obstacle.
Visage.
Je marche sur le sable du bas-côté ; parfois il n’y a pas d’espace où se tenir, je marche sur la route avec des embardées dans les fossés. La route zigzague toujours en montée abrupte, je frôle arbres et cactus. J’ai soif. Autonomie.
Enfin j’atteins une place, des immeubles, c’est le bas du village, géographiquement et socialement. Je demande mon chemin à une vieille bien choisie par mes soins, elle sursaute de ce frais fantôme. Jusqu’ici une seule route menait vers le haut, mais quand arrivent les places et les ruelles, et les lampadaires, les embranchements foisonnent. La route hors des murs pointait droit vers son but, à présent les rues choisissent toutes de contourner la pente.
Des escaliers raides, couper court, des impasses, l’instinct dit : toujours monter.
Enfin la place aperçue ce matin, me revoilà dans le plan.